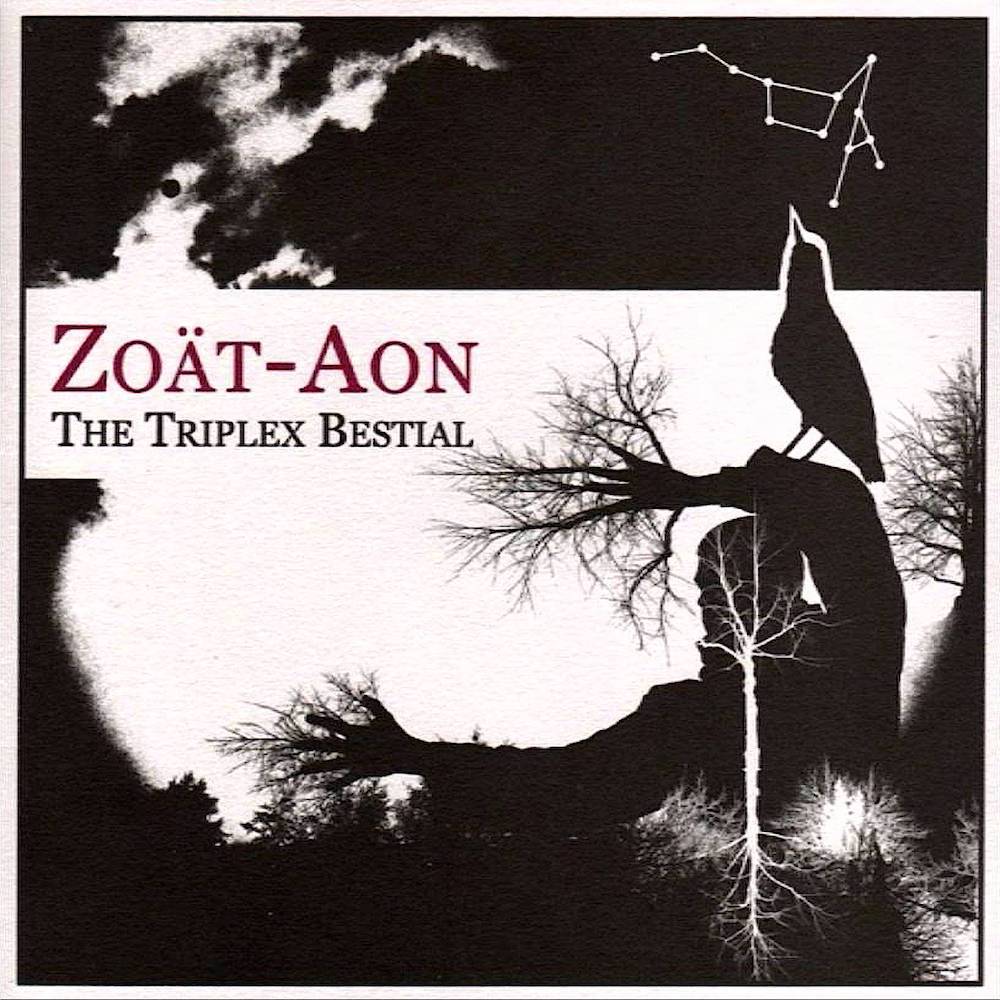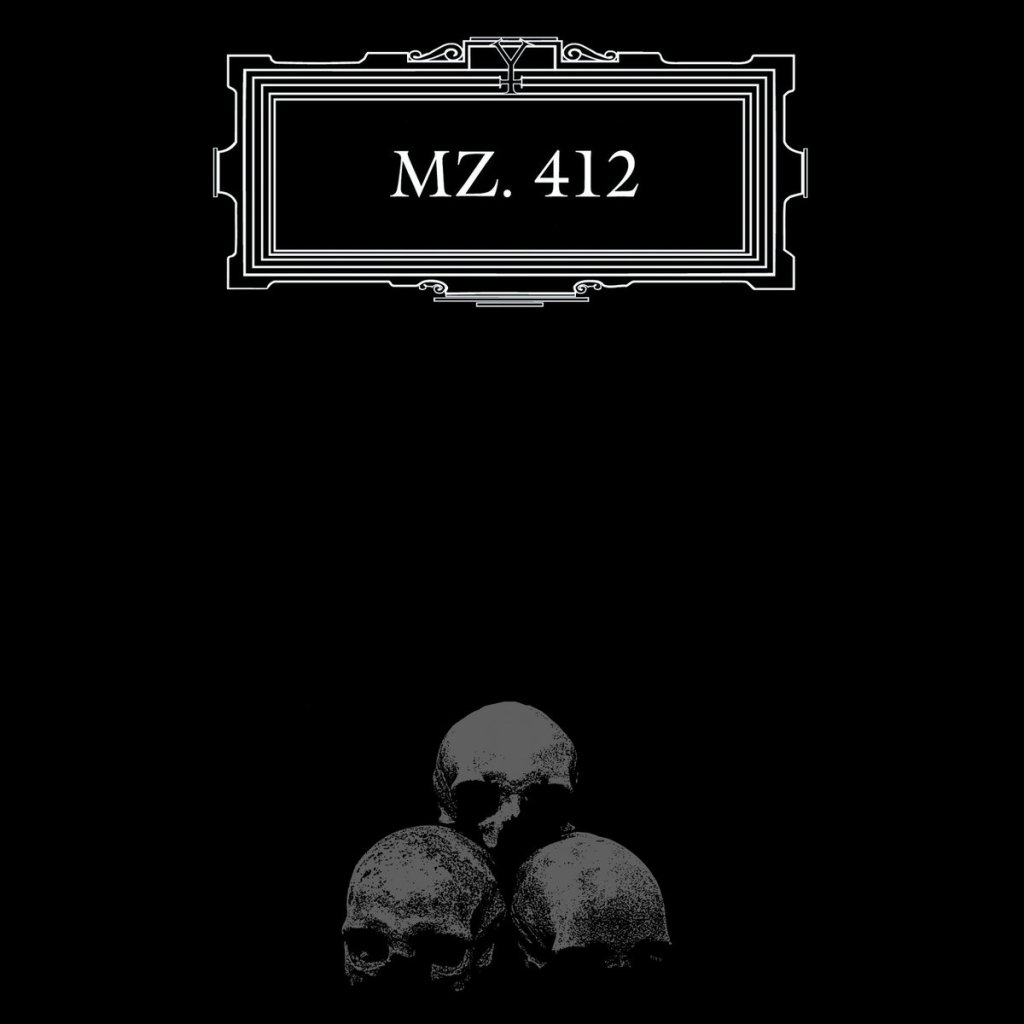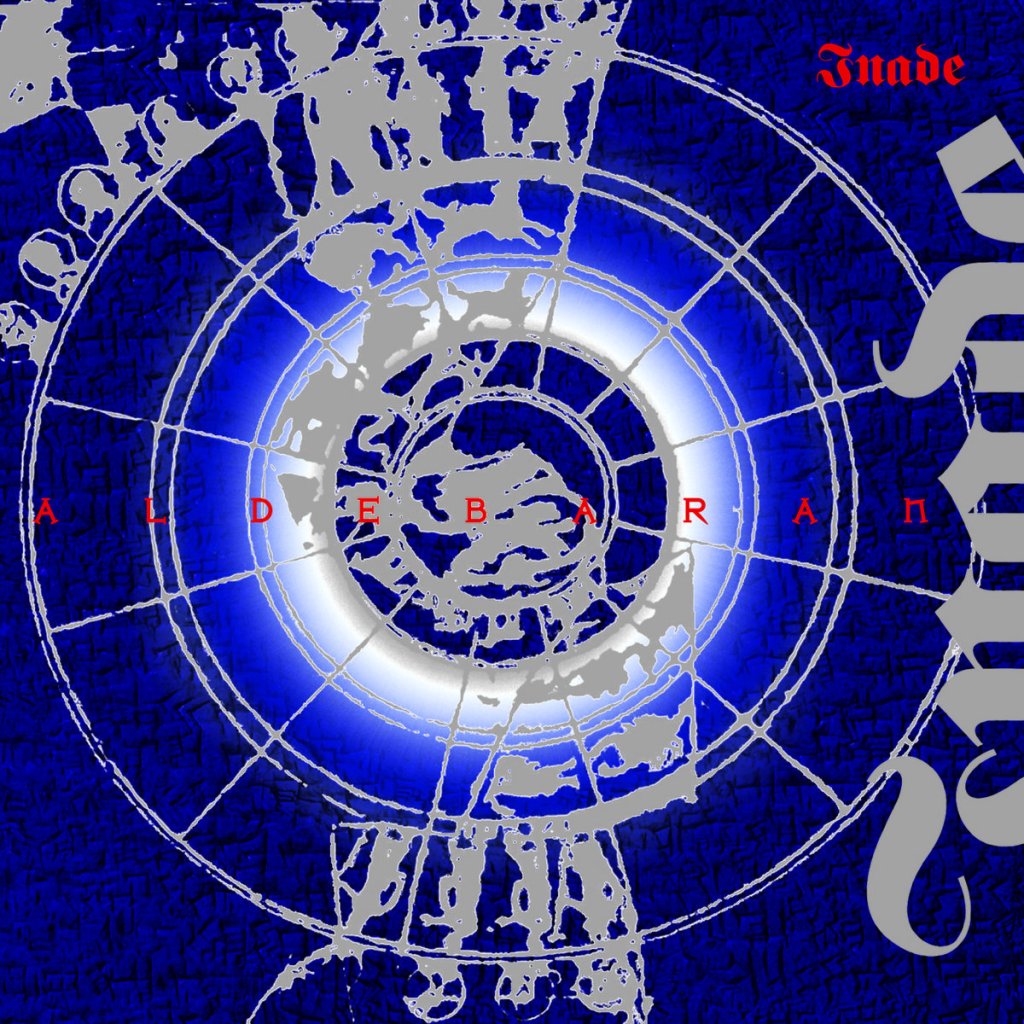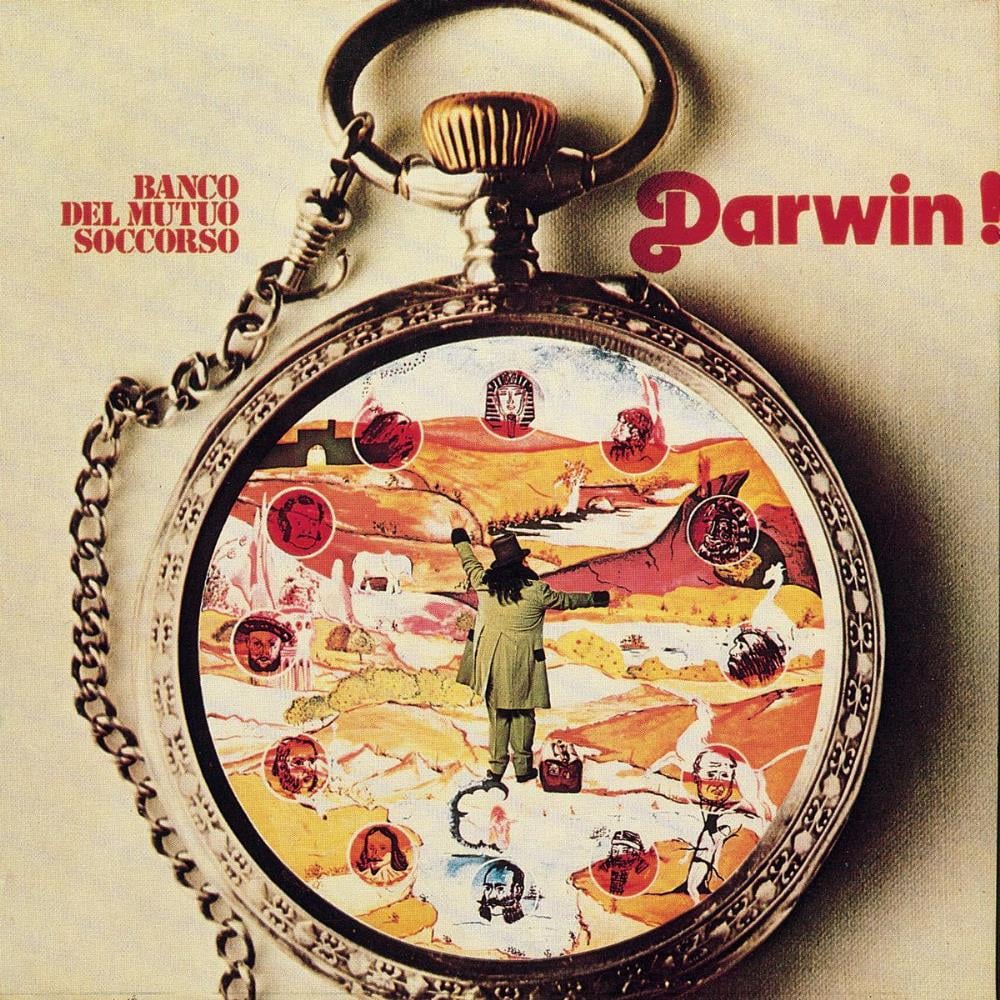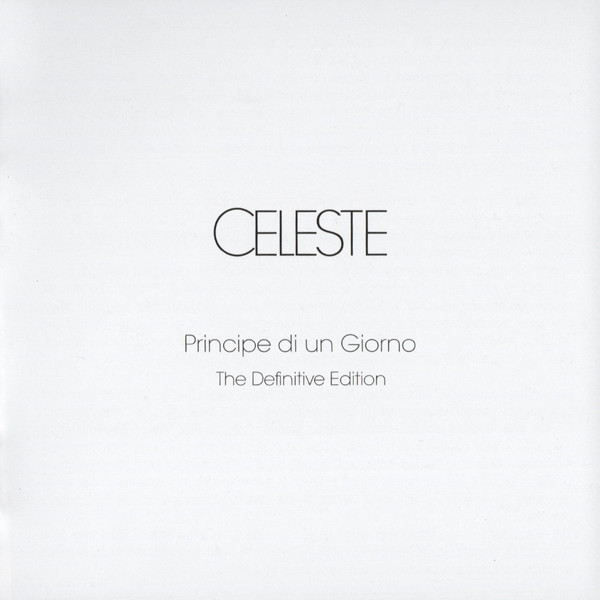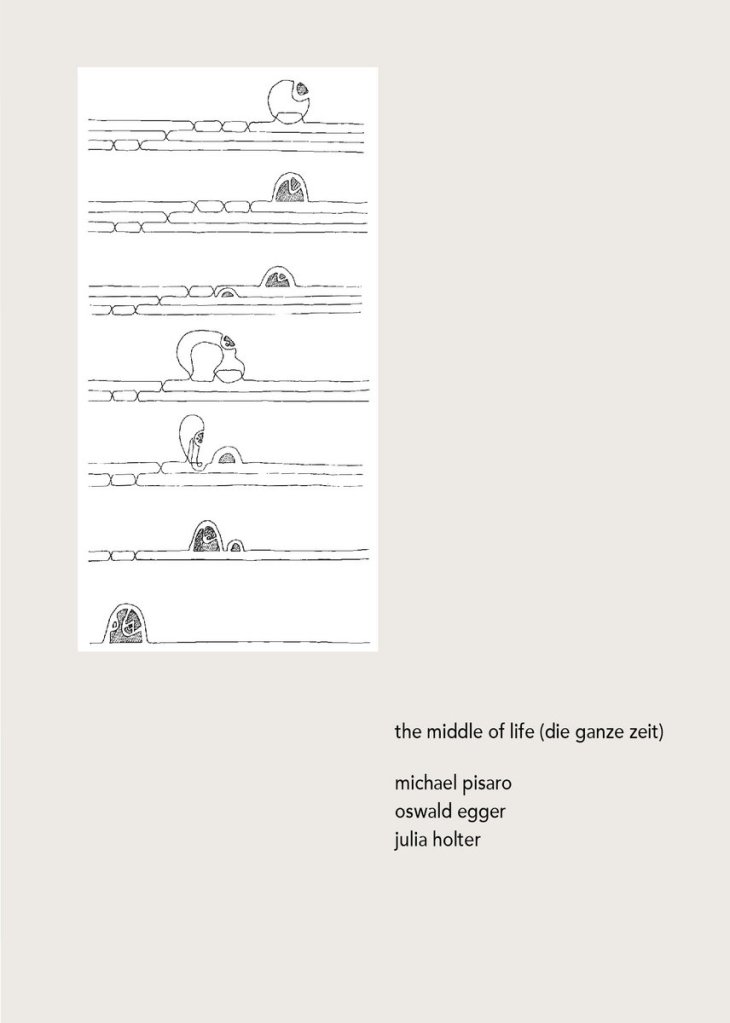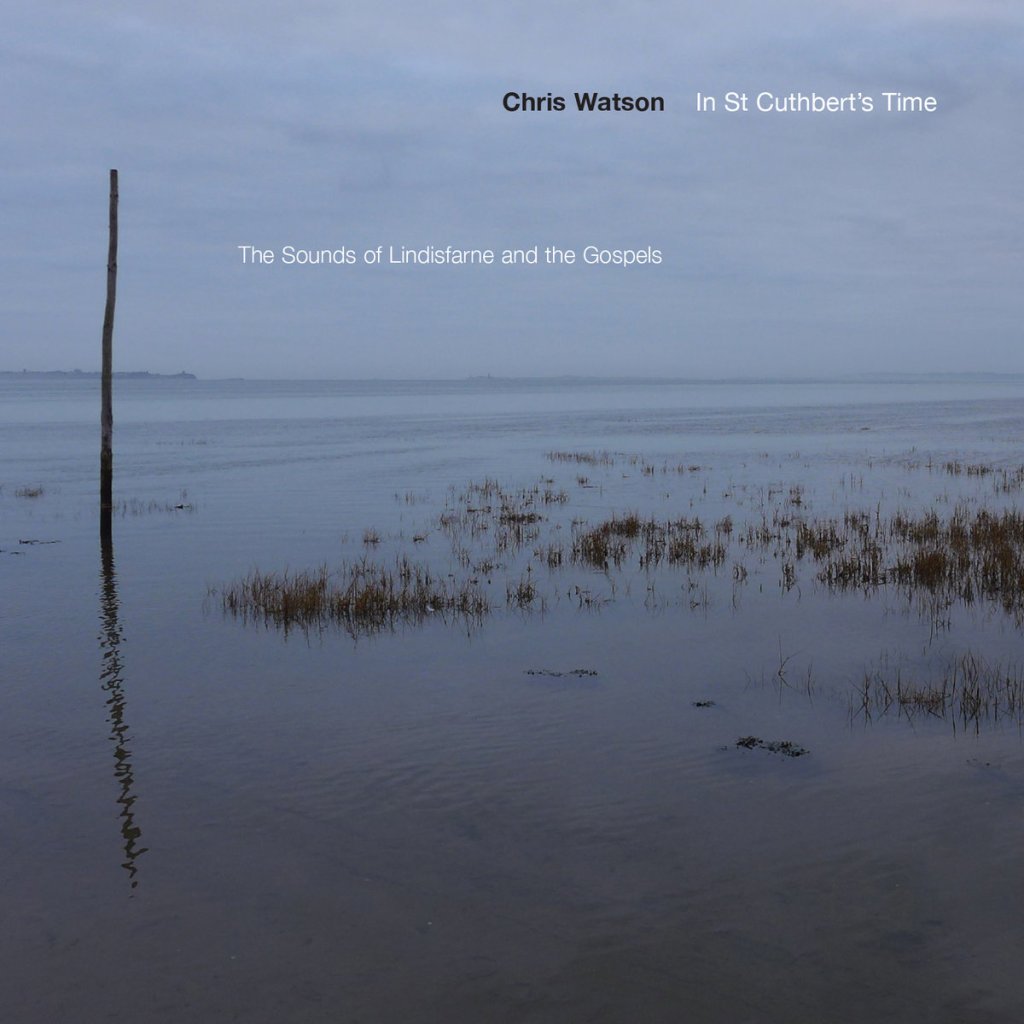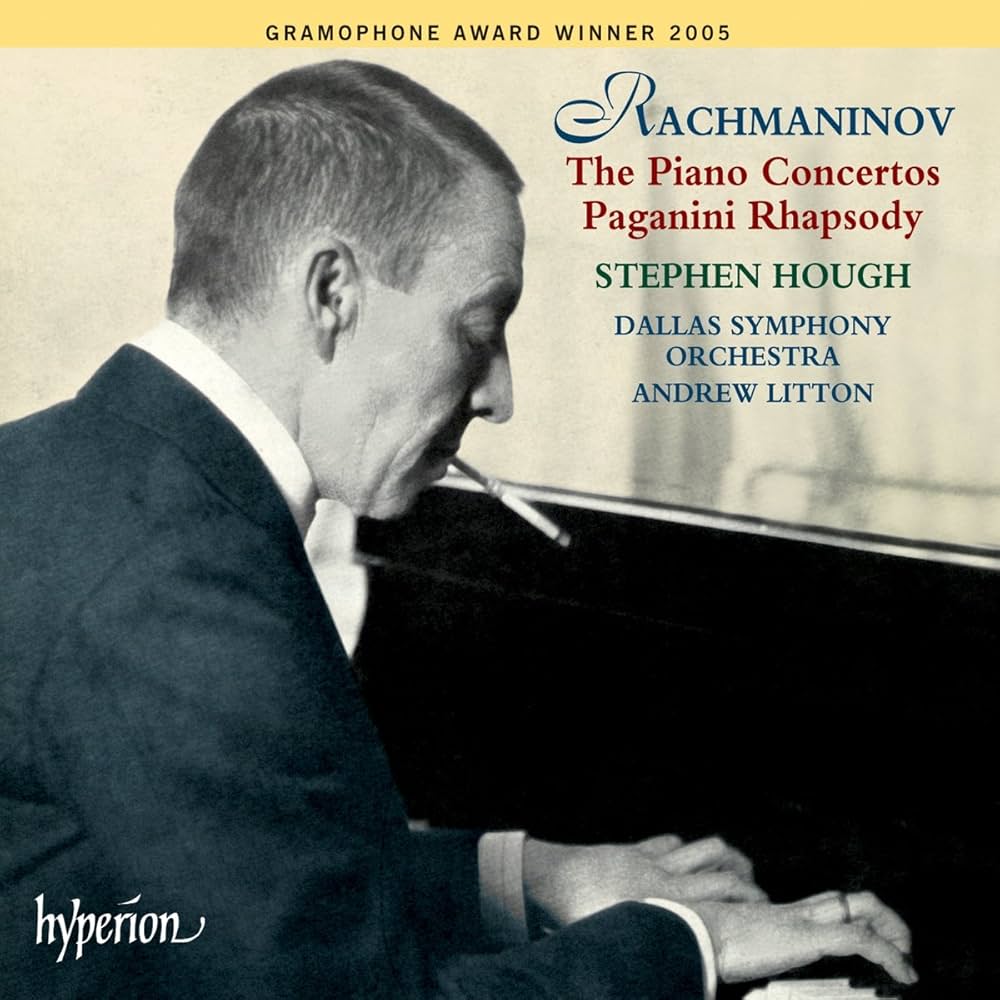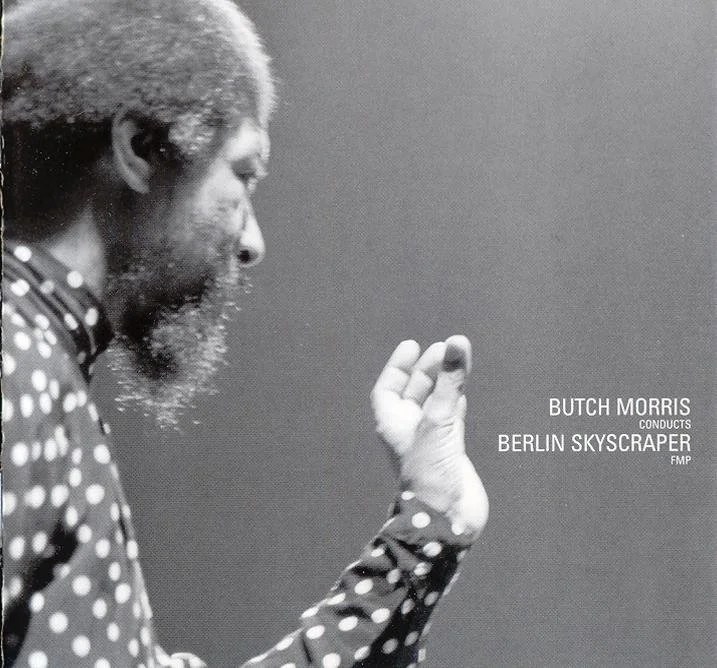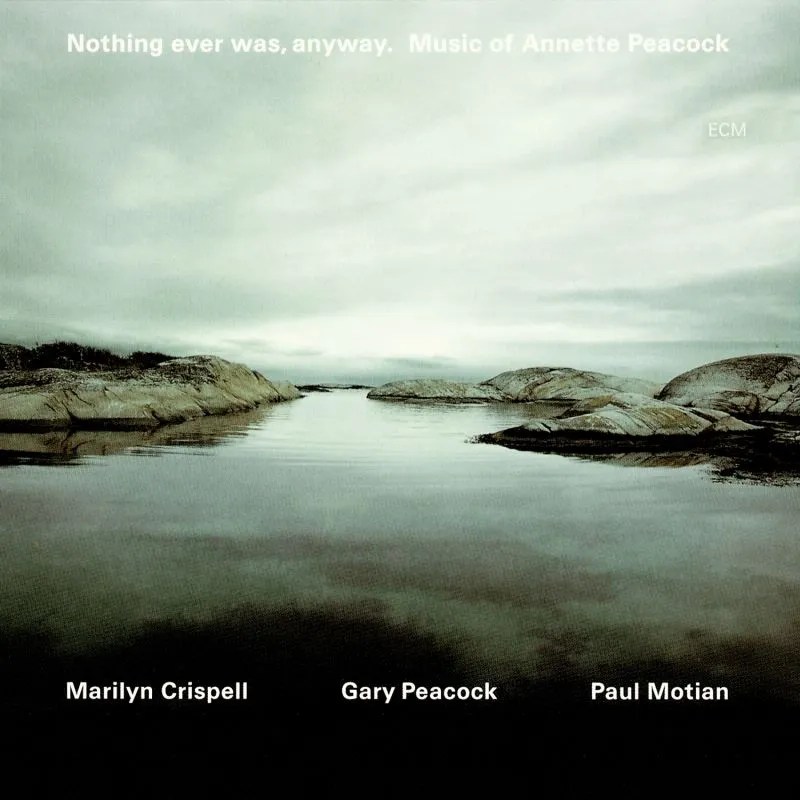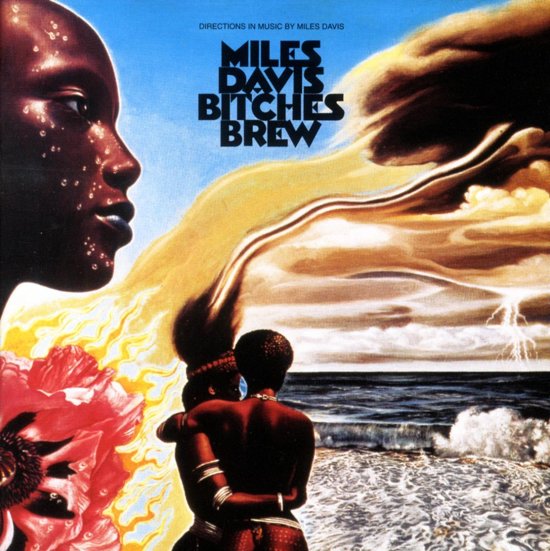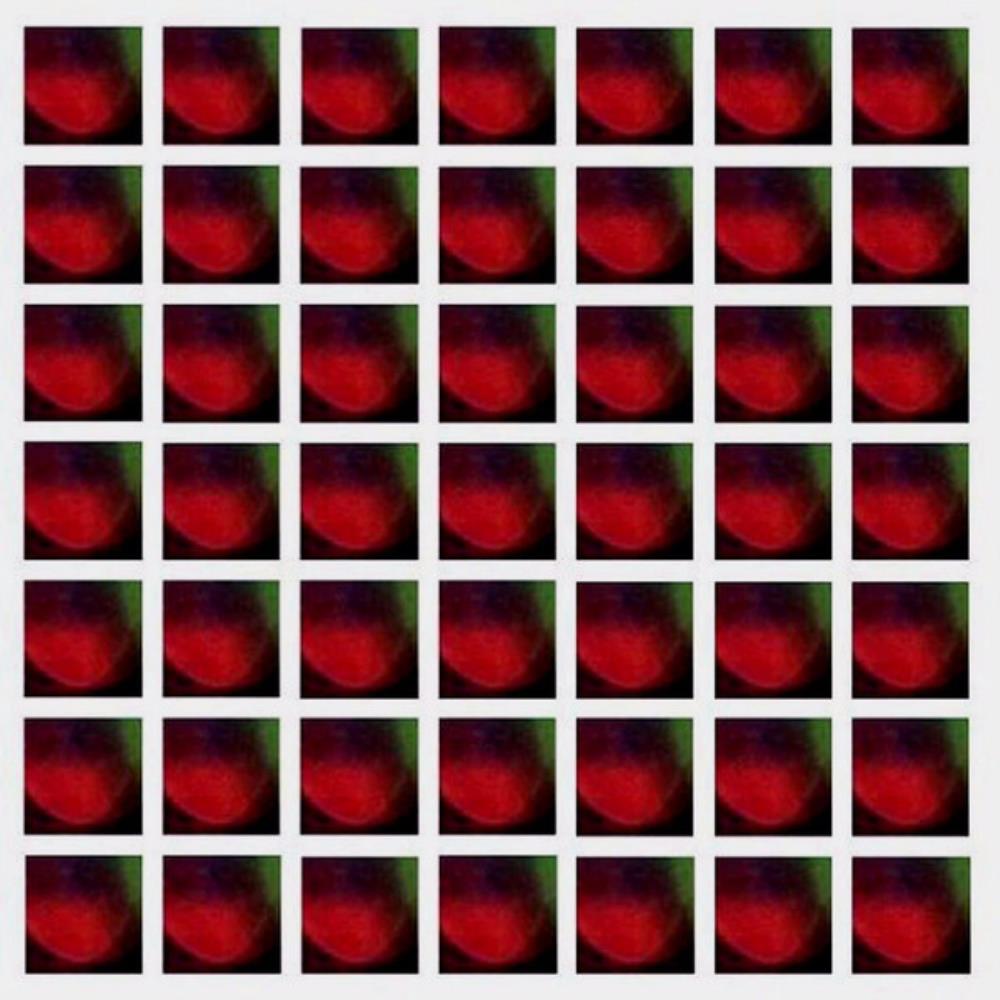| Année de parution : 2012 |
| Pays d’origine : États-Unis |
| Édition : 2CDs, Young God – 2012 |
| Style : Expérimental, Post-Rock, Folk, Gothique, No Wave, Blues, Industriel, Drone, Noise, OVNI, Terreur, 21th Century Schizoid Men (& Women) |
Tiens… Jusqu’à tout l’heure (et c’était déjà planifié depuis des lustres, je n’avais juste pas trouvé les mots justes pour parler de cette… immensité), j’étais bien décidé à vous introduire enfin aux charmes abominables de « Soundtracks for the Blind », l’autre testament des Cygnes, leur album double de 1996 qui avait mis fin à leur existence jusqu’à la réanimation du monstre dévoreur de mondes en 2010 par son géniteur, le père Gira. « Soundtracks » a été une révélation aussi glaçante qu’orgasmique pour votre humble chroniqueur masochiste… Il y avait TOUT dans cet album-foutoir-déréglé, TOUT ce qui me foutait la trique en musique à cette époque : du noise-rock ravageur qui te décapait la matière grise sans aucune subtilité, du post-rock funèbre qui t’arrachait le cœur à main nue pour passer dessus à coups de rouleau-compresseur (piloté par un Steve Reich réincarné en antichrist dément, au regard de suie et aux lèvres bordées d’écume), du trip-hop technoïde à la sauce Jarboe, du folk tout droit sorti du dustbowl era, de l’indus apocalyptique, du rock nihiliste de fin fond de saloon perdu dans la nuit sans lune d’une ville fantôme du sud du Texas… Bref, « Soundtracks for the Blind » est GRAND. Et il demeurera toujours un de mes albums préférés de tous les temps.
Mais, finalement, après une introspection cérébrale complète et totale, je ne peux me résoudre à en parler (du moins, pas maintenant…), parce que « THE SEER » a décidé de s’imposer à moi par ce soir sur lequel les cieux d’ébène crachent tout leur fiel. « The Seer » est tout aussi grandiloquent que son grand frère… tout aussi aussi colossal, mythique, faramineux… et encore plus noir (était-ce possible ?), encore plus fou, encore plus dépravé, encore plus monolithique, encore plus hypnotique, encore plus TOUT. C’est le disque des Swans post-retour qui s’impose à moi comme leur plus essentiel. C’est un disque-expérience. C’est l’album qui va trop loin et qui s’en moque. Michael Gira et ses acolytes déments vont au delà de vos cauchemars les plus terrifiants. Et ils en raffolent. Visions d’apocalypse, trous noirs dans un cosmos impie, douloureuses hallucinations opiacées qui tarissent le cortex de manière définitive et totale, mathématiques d’une certaine forme de chaos… L’espace temps n’a pour eux aucune importance. Ces missives possédées pourraient durer chacune une heure, un mois, un an… Ils vont au delà du temps lui-même. Ils sont à la recherche d’un absolu qu’on pourrait croire impossible, et pourtant, au fil de ces incantations-répétitives-jusqu’au-boutiste, ils le frôlent périlleusement, et ce, pratiquement en tout temps.
C’te musique, c’est comme une étoile qui s’apprête à éclater en Supernova à tout moment pour détruire absolument tout, mais qui n’y parvient jamais…. Coït interrompu et brutalement vicieux s’il en est. Swans, tout en conservant le son élaboré sur le précédent opus (« My Father Will Guide Me Up a Rope to the Sky »), se cherchent sur ces 2 disques, s’explorent et se scrutent froidement (au bistouri), cherchent à redéfinir l’innommable, se fondent en ténèbres sonores mouvantes, se noient dans le fleuve souterrain de la vie et de la mort, percutent l’irréel dans une course effrénée et sans fin…

L’Évangile selon Michael Gira. Voilà ce qu’est ce « The Seer », ou « le Voyant ». Ça s’ouvre sur « Lunacy », un espèce d’hymne désacralisé et post-apocalyptique qui fait autant penser à du Comus qu’au Nick Cave du début des Bad Seeds, avec en prime Alan Sparhawk et Mimi Parker du groupe Low qui entonnent ces chœurs dédiées à la folie. Dès cette première pièce, on comprend avec bonheur et horreur à quoi on à affaire. Ce son est communion. Ces musiciens sont dédiés à leur art et à cette vision totale et obsessive-compulsive de sieur Gira. C’est compact, lourd, carré, sans pitié et véloce à la fois. Et ça se termine avec cette guitare du sud et notre narrateur qui nous annonce que notre enfance est terminée… Quelle entrée en matière, non de dieu.
« Mother of the World » est juste sans pitié. Cette rythmique, tudieu !!! (la percu est absolument mystifiante). Et dans cette répétition funeste dans laquelle se greffe des éléments faramineux, une voix dérangée et féline vient nous miauler un mantra incongru. Et là… silence. Et respirations saccadées. Puis ça repart comme un train bourré de nitro pour se fondre dans un coda psychédélico-psychotique de cordes acoustiques et de piano désespéré. La finale est vachement « godspeedienne » tout en évitant le sublime pathos de nos Montréalais préférés. « The Wolf » ou le squelette d’un morceau folk perturbé des années 40, avec ces field recordings pétrifiants qui viennent nous annoncer de grandes choses…
« The Seer » arrive. Petite anecdote personnelle. Après une journée intense de canot durant l’été 2012, je me suis endormi (après maintes bières) dans un petit chalet old school sans électricité, en écoutant « The Seer » sur mon lecteur mp3. Quand la chanson titre est partie, avec son délire de cordes quasi noise-celtiques, de cloches, de cornemuse ensorcelée, je me suis réveillé en sursaut et en sueur, dans l’obscurité totale, sans savoir où j’étais ni qui j’étais. Et j’ai eu la chienne en TABARNAK. Le voyant, c’est 32 minutes en suspension dans un vortex d’anti-matière. Ça t’implose dans les oreilles et tu restes juste bouche-bée du début à la fin, un long filet de bave coulant au sol. I see it all, I see it all, I see it all, I see it all, I see it all… Fuck. Je l’écoutes présentement (alors qu’un orage dévaste le ciel nocturne, hachurant l’azur d’éclairs furibonds) et ça me fait encore le même effet. Ce sentiment d’être attaqué par une musique qui n’est plus que bête féroce qui veut te dévorer tout entier, s’agripper à la jugulaire, te vider de ton sang, célébrer ta chair, te pourfendre tout entier, te vomir, te rebouffer puis réduire tes os en poussière… J’aime particulièrement le moment « Home Depot FROM HELL » où on croirait entendre des scies circulaires en pleine action. Et puis cette saloperie prend tout son temps à imposer sa lourdeur dantesque. Chaque moment est gratuit, colossalement gratuit. Sont vraiment inhumains ces mecs… « The Seer Returns » continue l’errance dans cette nuit surnaturaliste et dentelée, avec la participation vocale aussi inouïe qu’inespérée de Jarboe, l’ancienne compagne de Michael Gira et deuxième tête pensante des Cygnes dans les années 80 et 90.
« 93 Ave. B Blues » est le moment le plus Scott Walker (ou « Maman, j’ai Peur ») du disque. C’est en quelque sorte la trame sonore de la rencontre entre Robert Johnson et ce bon vieux Satan dans un carrefour poisseux du fin fond du Mississippi dans les années 30… Dissonances, grincements insolites, éclatements percutants, cordes qu’on étripe, vocaux tout droit sortis d’un mantra indien dénaturé… Totalement habité, c’morceau. « The Daughter Brings the Water », avec sa néo-folk minimaliste et hantée, vint clore le premier CD de belle façon. Je ne parlerai pas du deuxième, tout aussi puissant. Je vous laisse découvrir la beauté spectrale de « Song for a Warrior » (chantée par Karen O), l’efficacité brute de « Avatar » (aucun lien avec le film avec les bonhommes bleus de Cameron, s’inquiète) et les deux morceaux-fleuves vertigineux de 20 minutes et plus qui concluent cette tentative irrationnelle et pourtant réussie qui est celle de nos acolytes : repousser la musique dans ses derniers retranchements.
Un disque comme il ne s’en fait pas. J’ai encore peine à croire qu’il existe.
Dans un même état d’esprit, Salade vous recommande :