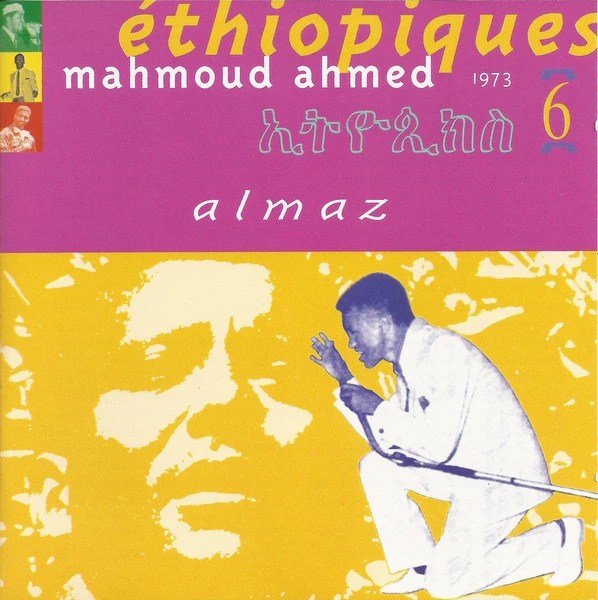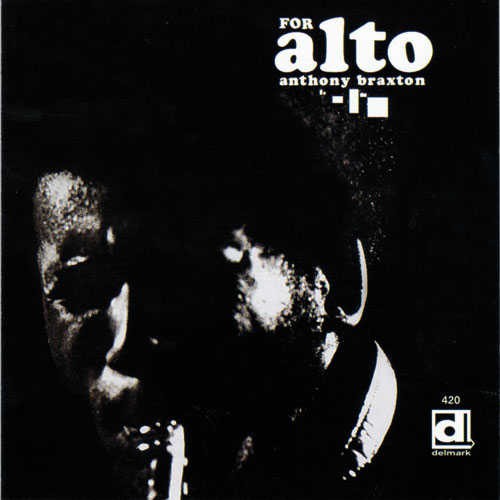| Interprètes : Herbert Von Karajan (direction), Orchestre philarmonique de Berlin, Anna Tomowa-Sintow (soprano), Agnès Baltsa (alto), Peter Schreier (ténor), José Van Dam (baryton-basse). Wiener Singverein (choeur) |
| Pays d’origine du compositeur : Allemagne |
| Écriture de l’oeuvre : 1822-1824 |
| Enregistrement : 1977 |
| Édition : Vinyle, Deutsche Grammophon – 1986 |
| Style : Musique classique / romantique (symphonie) |
Notes sur la version
Il existe plusieurs versions remarquables de cette symphonie (possiblement la plus connue mondialement ou du moins à égalité avec la 5ème de ce cher Ludwig Van). J’en possède d’ailleurs quelques versions. Pour cette critique, mon choix s’est arrêté sur Karajan, choix assez cliché s’il en est… Mais Karajan est le chef d’orchestre auquel on pense en premier en ce qui à trait Beethoven et ce, pour une bonne raison. Il a enregistré l’intégrale des symphonies du compositeur allemand pas moins de 4 fois (!!!) ; une fois par décennie plus précisément (des années 50 aux années 80). Cet enregistrement légendaire de 1977 date donc du troisième cycle et est probablement le plus célèbre. C’est aussi, à mon sens, la plus éblouissante version endisquée de cette oeuvre. Je recommande néanmoins chaudement sa version des années 1960 qui est hallucinante elle aussi.
Au niveau des versions « historiquement » plus exactes, je conseille fortement la version de John Eliot Gardiner avec l’Orchestre Révolutionnaire et Romantique (intégrale des symphonies paru initialement en 1994, en coffret CD). L’approche de Gardiner est toute autre que celle de Karajan, ce dernier étant plus « poussif » et prenant des libertés sur l’oeuvre de Beethoven. Gardiner, mi historien mi chef d’orchestre, tente de livrer un cycle symphonique TEL que Ludwig Von voyait ses oeuvres en son temps (instruments d’époque à l’appui). J’adore aussi cette approche et le travail d’orfèvrerie colossal que cela a du lui occasionner… Une version plus récente des symphonies qui vaut aussi son pesant d’or : celle de Kent Nagano (avec l’Orchestre symphonique de Montréal).

What you looking at, BEYOTCH !??
La 9ème… Dès qu’on prononce ces mots, on sait de qui et de quoi on parle. Nul besoin d’évoquer le mot « symphonie » pour savoir de quoi il est question : l’oeuvre musicale préférée de Alex DeLarge, anti-héros charismatique de l’Orange mécanique de Burgess ! « les anges aux trompettes, les démons aux trombones… vous êtes invitées! » proclame t’il à ces deux jeunes demoiselles/dévotchkas qui s’apprêtent à passer quelques moments torrides (à la vitesse grand V) avec lui… Et c’est tout à fait ça la 9ème. C’est luciférien par bouts et paradisiaque par d’autres ! C’est un voyage à travers le chaos originel (et ses ombres fugaces) avec comme destination finale : la lumière divine… Rien que ça.
La 9ème c’est contraste par dessus contraste. Ludwig n’était pas que sourd lorsqu’il a composé son « magnum opus ». Il était aussi bipolaire comme jamais il ne l’a été auparavant (du moins artistiquement parlant… je ne me prétends pas psychiatre sur le coup). On y trouve ses moments les plus violents, dramatiques, chaotiques, martelants, bestiaux même (coups de timbale à l’appui). Mais on y retrouve aussi ses instants les plus doux, sereins, voir angéliques. C’est une véritable guerre que se livrent ici ténèbres rutilantes et lumières salvatrices. La chape noire se voit transpercée épisodiquement de lueurs aux couleurs folles et oniriques…. Et tout ceci est subjuguant, fabuleux, euphorique, dantesque pour nos tympans gorgées à pâmoison d’une liesse sonore jusque là inusitée.
Prenez cet « Allegro ma non troppo » (le légendaire mouvement qui ouvre le bal). Des trémolos de cordes scintillantes qui s’élèvent dans la nuit originelle… Et puis cette célèbre intro orageuse vient nous happer en plein coeur, laissant place ensuite à ce thème ensorcelé qui nous assombri l’âme, oscillant entre subtilité méphistophélique et grandiloquence tellurique qui émerge et ré-émerge de manière toujours plus ahurissante. Ça monte, monte, monte comme un morceau de post-rock, mais avec des nuances tellement folles que le voyage vers l’apothéose est tout aussi fascinant que la destination en elle-même. Bon Dieu que ceci est riche. Chaque note a sa place dans un tout magistral de maitrise.
QUI sur terre n’a jamais entendu ce « Molto Vivace » foudroyant, à part peut être les fans du môme rocailleux (Kid Rock) et/ou les adeptes de QAnon ?!? C’est le hit numéro un de sieur Delarge (évoqué ci-haut), qu’il se mets en fond sonore alors qu’il se masturbe dans sa chambre en pensant à des scènes horribles. Cela a bien entendu laissé des traces sur la psyché du jeune adolescent impressionnable que j’étais… Grand moment de cinéma et musique de circonstance pour appuyer l’exaltation visuelle qui s’offre à nous. Ça va vite, très vite. Les cuivres sont sur les amphétamines. Les timbales sont des bourrasques de vent décoiffantes. Les cordes sont colère divine. Tout ceci est extatique en diable.

Place à la douceur céleste avec cet « Adagio molto e cantabile ». Que c’est beau, bordel. Les ténèbres sont vaincues (du moins momentanément). La lumière entre par tous les interstices, noyant tout doucereusement. L’élévation commence, en volupté. On quitte l’ébène, aspiré petit à petit par ce rayonnement séraphique. On vole au dessus d’étangs, de lacs, de vastes plaines, de petites bourgades encore endormies… puis au delà des montagnes aux cimes enneigés, au delà des nuages. La musique gagne en force (et en beauté azurée) alors qu’on monte toujours plus haut, vers un éden faîte de cordes et de cuivres élégiaques…
Le plus court « Presto » est rocambolesque à souhait. Une entrée en matière belliqueuse, dans le fracas de l’orchestre possédé. Puis, une version un brin inquiétante de « l’hymne à la joie » fait irruption…. saccadée par les derniers remous de noirceur hirsute et de doute lancinant… Cet hymne veut vivre et combat le mal pour pouvoir exister sans contrainte. C’est les cordes basses qui accouchent de sa version formelle d’abord…. il faut tendre l’oreille pour savourer cette prémisse. Puis les autres cordes s’en mêlent et l’étincelle prend vie. Et puis tout s’embrase. L’orchestre au grand complet. C’est un des plus beaux moments de l’histoire de la musique occidentale.
Dernier mouvement. Place à la voix. Quoi ?!? Des voix humaines dans une symphonie ? À l’époque, cela était une grosse entrave au format symphonique qui sévissait… Beethoven, en fin de vie, possiblement aigri, sourdingue… en avait marre des conventions de la forme classique. Il défie les règles, donne tout ce qu’il a, tout ce qu’il lui reste de grandiose en lui ; que cela déplaise ou non aux intégristes… Ici, il mets bas au romantisme (et à tous ses excès émotifs). Et cette naissance est ravissante jusqu’à plus soif. C’est un feu d’artifices qui explose de partout. Les voix humaines triomphantes, l’orchestre en transe, le chef qui se tricote une future tendinite. C’est orgasme par-dessus orgasme. Du squirt symphonique. Ça jute de partout. Tout le monde est éclaboussé. C’est presque trop (diront certains) mais c’est exactement ce dont la musique « at large » avait besoin. D’une autre révolution. De la plus belle des révolutions.
Je sais que ma chronique n’est qu’une énième tentative d’exprimer toute la folle génialité de cette oeuvre (avec de vulgaire mots)… C’était destiné à échouer. Mais je tenais à vous communiquer tout de même mon amour débordant pour ma 9ème chérie. Et je voulais à tout prix que cet exploit phonique se retrouve chroniqué sur notre petit coin du web.
Dans un même état d’esprit, Salade vous recommande :