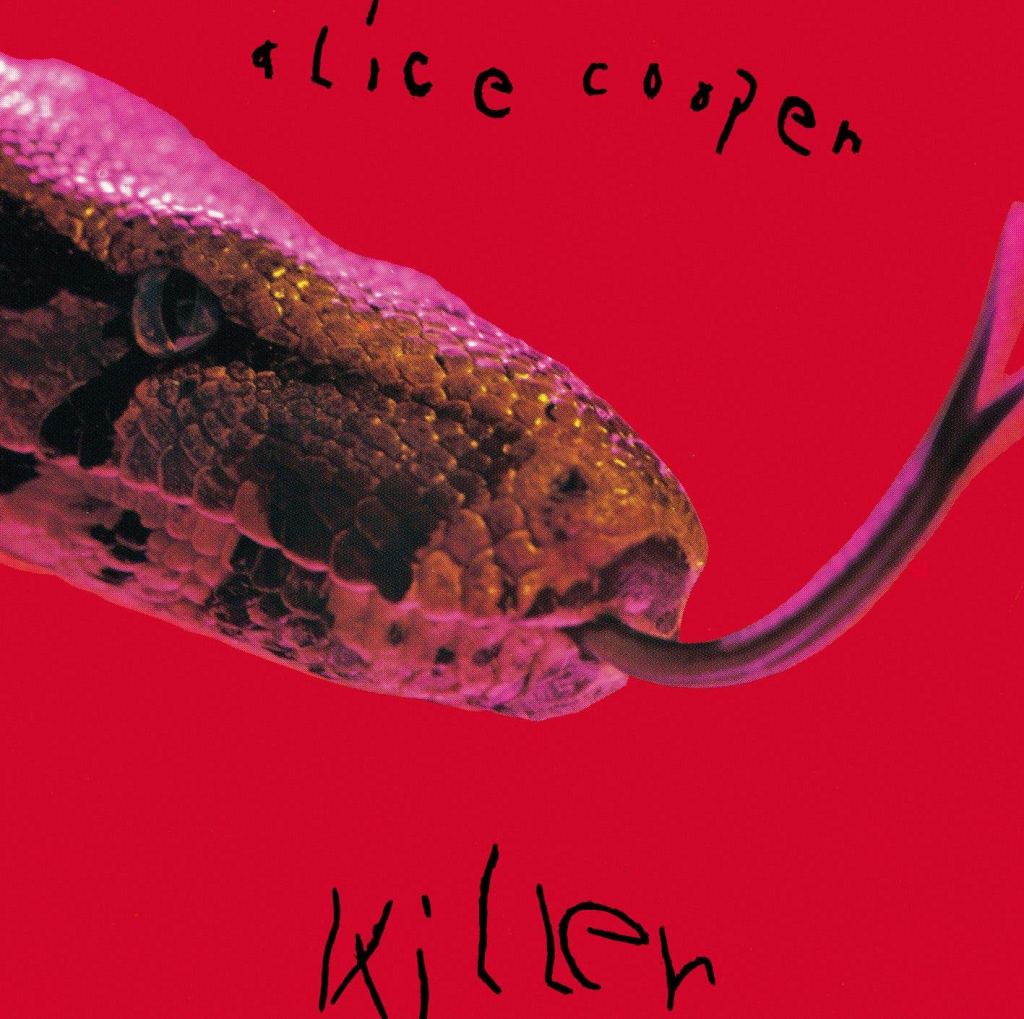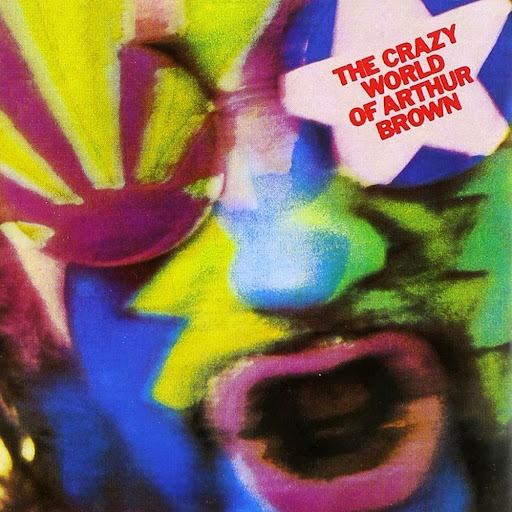| Année de parution : 1971 |
| Pays d’origine : Allemagne |
| Édition : SACD, Mute – 2005 |
| Style : Krautrock, Rock Psychédélique, Stockhausen-Prog, Funk Extra-Terrestre, OVNI |
Je ne passerai pas par quatre chemins : Tago Mago est un de ces monuments emblématiques de la musique du 20ème siècle qu’il se faut de posséder. C’est un disque essentiel à toute discographie (et ce, même si vous avez uniquement du classique ou du reggae dans vos armoires). Cet album dépasse tout, confond tout, détruit tout ; toutes les limites et frontières musicales possibles… Rock psychédélique, prog, musique concrète, pop, proto-électronique, free jazz, musique tribale (celle qui est enfouie dans les zones les plus reculées du cerveau humain et ce, depuis des siècles). C’est un énorme morceau de bravoure, de folie, d’expérimentation brute, de plaisir, de rêve, de cauchemar, d’euphorie, de noirceur et de transe (surtout). C’est ce qui en musique s’approche le plus de l’envoûtement voodoo. C’est un truc 10 ans en avance sur son temps (voir même mille). C’est le Disco Volante des jeunes années 70. C’est aussi probablement le Sgt Pepper du Kraut-Rock – l’album qui représente le mieux l’étendue de ce genre musical influent qui n’en est pas vraiment un. C’est la musique que produirait des psychiatres qui bossent à l’aile des schizos si ils formaient un groupe de rock avec leurs patients les plus atteints (ce mélange génie-démence-rigueur-liberté qui marche à tout coup). Ça peut être la porte d’entrée à un million de trucs qui peuvent changer la vie d’un mélomane : le kraut-rock, le prog, la musique classique moderne, la musique électronique, le math-rock, la musique tribale (de tout pays), etc… J’insiste : vous devez au moins expérimenter une fois dans votre vie les méandres de Tago Mago. Vous allez peut-être adorer. Vous allez peut-être détester. Mais surtout, vous n’en sortirez pas indemne, je vous le promets.
Il ne faut pas passer sous silence que ce deuxième album souligne l’arrivée officielle de Damo Suzuki en tant que chanteur de Can (on l’avait entrevu sur l’excellent Soundtracks…), un changement majeur dans l’histoire du groupe, qui ne sera plus jamais pareil après le passage de cette tornade vocale humaine incongrue. Ce sympathique cinglé de service avait quitté son Japon natal (un pays riche en fous de toutes sortes) quelques années auparavant pour faire le tour de l’Europe, guitare à la main – histoire de faire un peu d’argent de poche. Remarqué dans les rues de Munich par Holger Czukay et Jaki Liebezeit alors qu’il exerçait son art (ça devait détonner des autres chansonniers), il est invité à se produire avec le groupe le soir même (voilà un concert auquel j’aurais aimé assister !). C’est le coup de foudre psychotronique instantané ! Armé de ses cordes vocales supersoniques, le jeune Suzuki vient accentuer et colorer l’intensité déjà palpable de la musique de Can. Grand improvisateur usant de son organe vocal comme d’un instrument polymorphe, Damo chante comme un possédé sur Tago Mago. Il chuchote mystérieusement par moments, hurle grotesquement par d’autres, créé sa propre pièce de théatre « Nô » sur l’acide, imite parfois le bruit d’un poulet qu’on étrangle à mains nues, chante dans des langues inconnues qu’il invente à mesure mais qui sont pourtant géniales (forcément, en tant que fan de Magma, ça vient me chercher). Bref, Damo devient par le fait même une part intégrante du son du groupe et restera avec eux pour ce qui est considéré par beaucoup comme leur meilleure période créatrice.

Holger Czukay et Damo Suzuki
Imposant album-double de 70 minutes, Tago Mago débute sur les chapeaux de roues avec l’incroyablissime « Paperhouse » : une brève intro space faîte en ondulations de claviers et on est tout de suite projeté au pays de la rythmique qui tue. Cette rythmique insoutenable, marque de commerce de Can, vient nous happer, nous ensorceler, et ne nous lâchera pas avant la fin de l’album (à part à quelques moments de folie atonale). Ce qui débute comme une sorte de ballade prog acide et amère devient une montée des plus hallucinantes (de quoi faire rougir la plupart des groupes de post-rock), portée par le délire ordonné (encore une fois le parallèle folie-raison) de cette guitare psychée jouée à perfection et de cette batterie venue de l’au-delà. Je tiens à préciser : bordel que cet album ne sonne pas « 1971 » ! Dès que cette pièce d’ouverture atteint son apothéose, on tombe dans le trouble avec « Mushroom », mystérieuse pièce qui porte en elle son lot de mystères indomptables… On sent le malaise sous-jacent à travers la rythmique proto-industrielle, cette basse funky et sombre, ces percussions recouvertes d’échos et de réverbérations et les hurlements imprévisibles de Damo. L’ascension du délire se poursuit avec l’incroyable « Oh Yeah », qui débute avec le bruit d’une explosion nucléaire que semblait nous annoncer « Mushroom ». En parlant de « Oh Yeah » : jamais titre n’aura aussi bien porté son nom. En écoutant ces 7 minutes de pur génie, j’ai juste le goût de me mettre à danser aussi frénétiquement que maladroitement et de HURLER le titre de la chanson à tout rompre entre les murs de mon bureau, tel un beau criss de cave (ah… la magie de la musique !). Ça débute avec possiblement la rythmique (le mot le plus sur-utilisé de la chronique) la plus bandante qui soit, agrémentée de quelques couplets chantés par Damo mais dont les bandes sont jouées à l’envers… On sent que ça monte vers quelque chose de grand, d’incompréhensible, de « plus fort que toi »… puis la musique s’arrête soudainement, et repart de plus belle avec cette fois une guitare bluesy interstellaire à l’appui et des vocaux anglo-nippon-what-the-fuck. Dantesque ! Ce petit chef d’oeuvre pourrait facilement être le climax d’un disque déjà parfait mais le plus fou reste encore à venir (oh que oui !).
« Halleluhwah », du haut de ses presque 20 minutes, est une jungle sonore où il fait bon se perdre. Ce beat, mon Dieu, CE BEAT ! Le Funk a été invité au rave tropical et il a amené ses potes jazzmen le temps d’interludes savoureux au piano. À part ces passages plus tranquilles, cette pièce est surtout l’heure de gloire de Jaki Liebezeit, Dieu-percussioniste de son état. Le beat qu’il produit (ainsi que ses variations multiples et virtuoses) se trouve à être le coeur du morceau, sa colonne fondatrice à laquelle vient se greffer une foule d’éléments disparates savoureux… comme ce violon déchaîné, ces claviers psychédéliques qui sont aussi cheap qu’inquiétants, cette basse sourde et bien sûr Damo dans toute sa gloire caractéristique. On tombe ensuite dans la portion plus extrême et expérimentale de Tago Mago, avec « Aumgn » et « Peking O »… Bienvenue dans un enfer stockhausenien des plus pétrifiants et où toute forme de mélodie disparaît dans les limbes. « Aumgn » est une sorte de collage ambient qui pourrait faire office de trame sonore à un film préventif sur l’usage du LSD. Il ne fait pas bon de s’endormir en écoutant cette portion du disque… Les rêves qui s’ensuivent sont, disons le, plus ou moins traumatisants. On navigue ici à travers une brume sonore épaisse qui est l’amalgame d’une tonne d’effets sonores de studio (signés Irmin Schmidt), de field recordings de chiens qui jappent, d’impros musicales sur le thème du « cirque dérangé » et surtout de cette voix, sinistre au possible, qui repète inlassablement AUUUUUUUUUUUUMGN (Aleister Crowley in DA HOUSE). Dans le genre « maman, j’ai peur », « Peking O » est elle aussi dure à battre. C’est certainement le morceau le plus psychiatrique de toute la discographie de Can. Trop dur de parler de cette chose époustouflante… sinon que c’est probablement un truc que les membres des Boredoms ont écouté à répétition à leur adolescence.

Tago Mago revient à une certaine forme de normalité avec le dernier morceau, « Bring Me Coffee or Tea », sorte de ballade-transe brumeuse qui vient clore à merveille ce périple sonore des plus audacieux. Et il est vrai qu’après avoir fait le tour de 8000 galaxies le temps d’un album, il est bon de se réconforter avec une bonne tasse bien chaude… et de se demander si on y replonge tout de suite tête première… car ce disque est une drogue. Ce n’est plus de la musique comme on en entend normalement (avec de jolies mélodies et des belles idées). Non. C’est de la « matière sonore brute, libre et savante » qu’on s’injecte dans les tympans avec plaisir. Deviendrez-vous accros comme moi ?
Dans un même état d’esprit, Salade vous recommande :