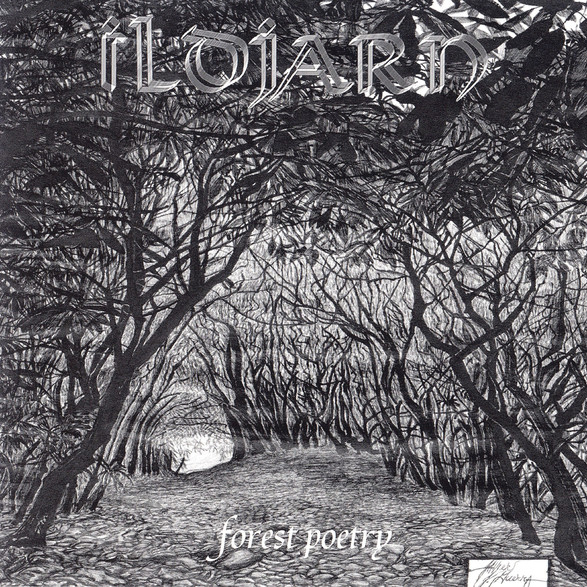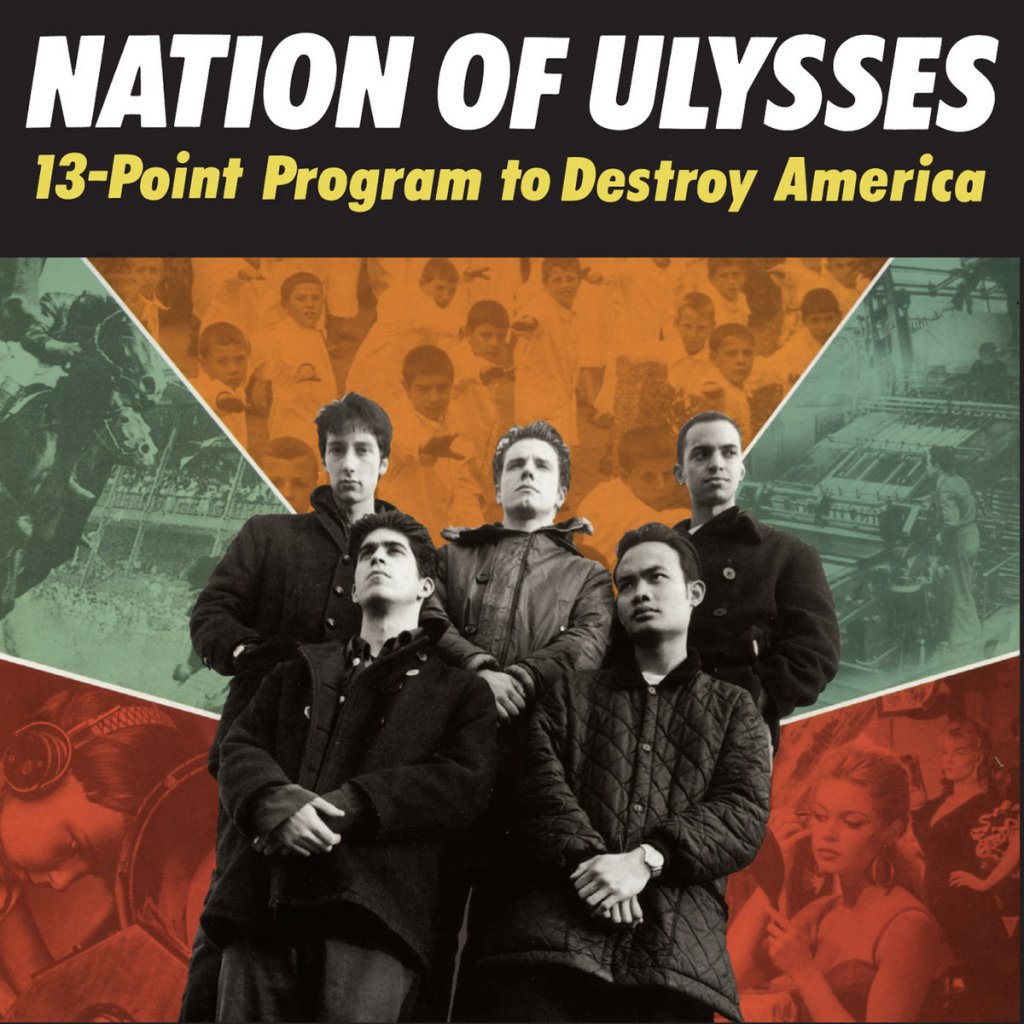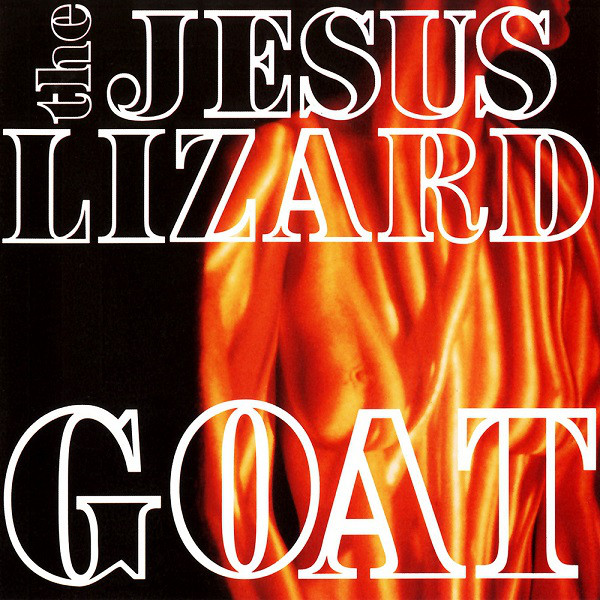| Année de parution : 1993 |
| Pays d’origine : Pologne |
| Édition : CD, No Colours – 1996 |
| Style : Black Metal |
Aaaaaaah…. le vieux Graveland. Le Graveland vicieux, cru, guerrier, acariâtre, antipathique, acerbe, renégat, suranné, occulte à l’osssssss. Cette démo est une des plus légendaires du style. Elle est laide. Magnifiquement laide. Lo-fi au boutte. Nom d’album (et pochette) sans équivoque, faisant référence aux petites sauteries nocturnes de leurs collègues norvégiens. Une intro où on entend le joyeux crépitement des flammes, des chants médiévaux et des cris (grotesques) de femme qu’on imagine au bucher. Superbe entrée en matière. Et puis ça part…. le morceau titre. Compressé à l’os. C’est comme si tous les instruments sont pris dans un gros pain de boulangère bien compact (et dont la « mordée » vous arrache une dent). Et il y a ces… ahem… vocaux ? Est-ce qu’on peut qualifier ça de vocaux au juste ? Ce sont des cris de canard haut perchés, abominables, ignominieux, orduriers, presque ridicules dans leur côté jusqu’au boutiste. Bordel, c’est TELLEMENT HAINEUX. Et il y a les claviers atmosphériques de perdus dans la bouillie sonore infâme… En fait, tout est perdu sous la nuage lo-fi (production ? C’est quoi une production ?!?). TOUT. la basse n’existe juste pas. La guitare est en 8-bits. Les claviers victorieux de donjon de J-RPG semblent être diffusés par un gramophone antique qui ne tourne plus rond. Bordel que j’aime ça. Il n’y a que les vocaux horripilants qui triomphent et qui semblent être sur le point de faire fondre la mothafuckin’ cassette.
Ensuite, c’est « The Night of Fullmoon ». Sous la pleine lune, les riffs sont assassins et Rob Darken se prend pour un loup-garou ; un loup-garou dont la gorge semble cracher des grumeaux morveux de Coronavirus (restons d’actualité). Un « middle break » complètement jouissif survient alors que le chaos sonore approximatif menace de l’occulter à tout moment. Capricornus y va de passes de batterie très atypiques (du moins pour du BM Raw). On a toujours l’impression que la bande va rendre l’âme, comme si autant de rage caverneuse ne peut tout simplement pas « fitter » sur le format… Voici venir l’intermède « The Dark Dusk Abyss », là où le bon Robert est à son plus « Castlevania ». Clavier moisi réglé en mode « orgue crousti-licieux ». On imagine Simon Belmont, le visage barbouillé de corpse paint, pourfendre des créatures malséantes avec son fouet taché de sang noir et recouvert de bouts de peau faisandée.

Reprise des hostilités avec un « Through the Occult Veil » bien cafardeux et cryptique. Magnifique morceau de Black Metal mid-tempo que voilà. Le mur de son de Phil Spector au service du mal absolu. Quand on dit que le Black Metal cru est en fait de l’Ambient primitif, on ne se trompe pas. Tous les instruments sont tellement enchevêtrés en un tout difforme et hypnotique que cela peut s’apparenter effectivement à de l’ambient… de l’ambient mort, pourri, détérioré, corrompu… « For Pagan and Heretic’s Blood », dernier morceau de la démo cassette d’origine fait ensuite irruption dans notre appareil auditif. C’est fichtrement punky, avec un Rob Darken qui vomi copieusement un texte bien rageur envers et contre ces satanés Chrétiens (toujours eux) qui ont, jadis, détruit la riche culture païenne à laquelle il tient tant.
Sur mon édition CD de No Colours, on a droit à 3 morceaux bonus (de la même époque). D’abord, un instrumental bien glauque et transi, très Burzumien, et qui laisse présager les réalisations futures de Lord Wind (le projet Dungeon Synth / Néoclassique de Darken). Puis, le black monochrome refait surface dans nos enceintes poisseuses avec un « Hordes of Empire » qui ressemble à une fusion froide entre Ildjarn et le Emperor des débuts. Et on termine avec un de mes morceaux préférés de Graveland, « The Gates to the Kingdom of Darkness ». C’est l’amalgame de tout ce qui est jouissif du BM raw et atmosphérique. De la rage, du grain, de l’épique, de la déraison, de la fougue, une certaine forme de noblesse pervertie, de l’incohésion fabuleuse et véloce, de la folie… J’adore quand l’orgue casio revient pour tout englober de ses ronronnements doucereux… Et puis ça se termine avec « L’outro ». Retour à la grande fête païenne, avec le vent qui balaie les décombres du village brûlé et la poussière des moribonds calcinés. De la joie mesquine, perfide, evenimée…
Dans un même état d’esprit, Salade vous recommande :