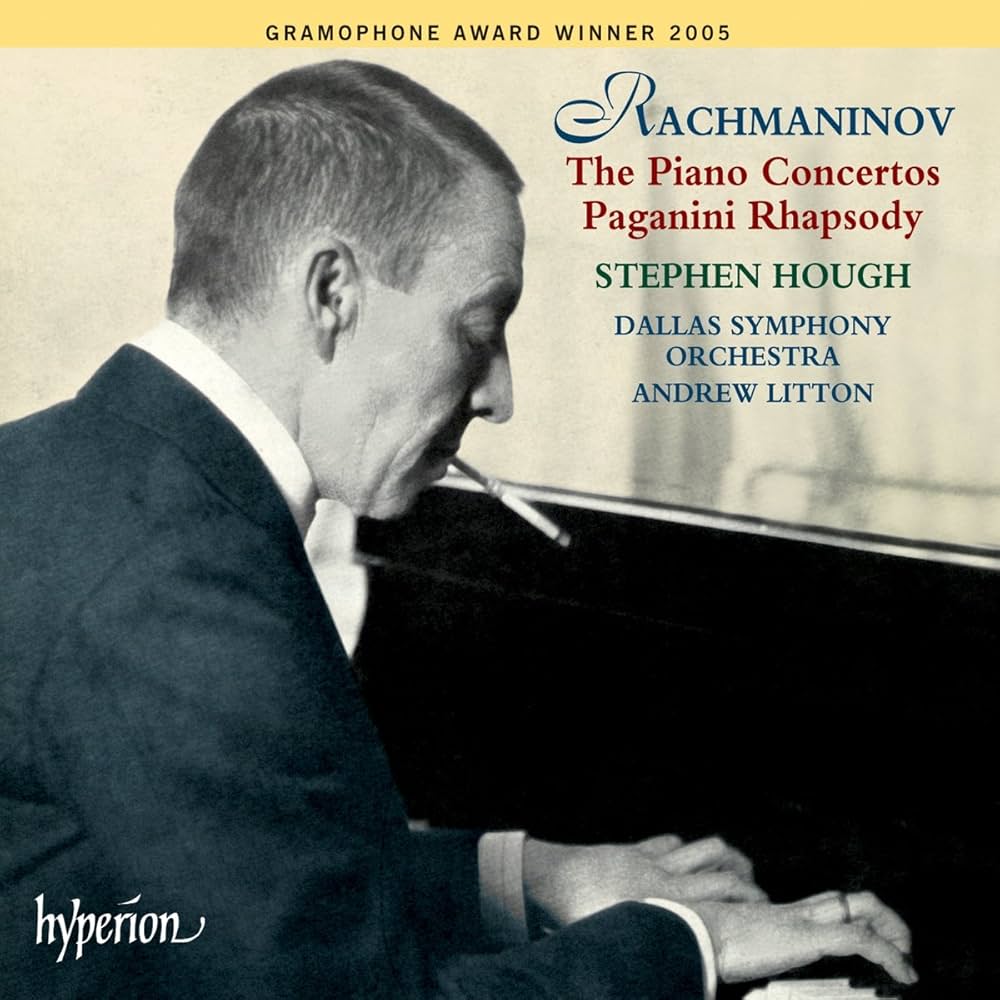| Interprètes : Seiji Ozawa (direction), Orchestre symphonique de Boston, Krystian Zimerman (pianiste) |
| Pays d’origine du compositeur : Hongrie |
| Écriture des oeuvres : 19ème siècle |
| Enregistrement : 1987 |
| Édition : CD, Deutsche Grammophon – 1988 |
| Style : Musique pour orchestre et instrument solo (piano) / Romantique |
Grandiose et dantesque !
De un, il y a Ozawa le terrible. MON chef d’orchestre « violent » préféré ; je l’ai même qualifié de « Grindcore » dans ma critique de sa version du Sacre du Printemps de ce bon vieux Igoooorrrrrrrrrrr Stravinsky (sa version demeurant MA version de référence absolue). De deux, Ozawa se retrouve en compagnie d’un certain Krystian Zimerman : pianiste de génie qui est surtout reconnu pour son raffinement, sa technicité exemplaire et son élégance… Mais ce cher Krystian, sous l’influence (perfide) du Japonais qui n’est pas là pour rigoler (mais plutôt pour foutre des raclées aux conduits auditifs des mélomanes les plus endurcis), laisse ici tomber un peu son naturel effacé pour se plonger corps et âme dans le pathos primaire et l’émotivité brute de la musique du compositeur hongrois. La chimie opère à fond. C’est donc une rencontre artistique monumentale et furieusement efficace. Les deux hommes, secondés à merveille par l’orchestre symphonique de Boston, deviennent une véritable machine de guerre et de volupté prête à rendre justice à un programme assez costaud comprenant les deux concertos pour piano et la succulente danse macabre de Franz Liszt, soit les 3 oeuvres les plus majeures du monsieur.
Le premier concerto, d’une facture un peu plus classique, est l’oeuvre idéale pour entrer dans la matière. Après une introduction véhémente de l’orchestre, Zimerman entre en scène et s’empresse tout de suite de casser la baraque et de prouver qu’il est l’homme de la situation… Il s’agit là aisément d’une des plus remarquables performances de pianiste jamais enregistrée (et je pèse mes mots)… Chaque note s’envole des enceintes avec volupté et/ou déchaînement et atteri dans mes tympans avec délice… Dans les passages plus tranquilles, il joue avec toute la sensibilité et la poésie qu’on lui connaît. Dans les passages plus infernaux, son jeu est musclé, agressif, envolé, viril, puissant, pléthorique… Mais jamais trop. Juste bien dosé ; toujours du bon côté de la ligne entre exubérance et justesse. Bref, il est PARFAIT pour ce que la musique de Liszt est : un concentré brut d’émotion, de souplesse et d’impétuosité.
Le second concerto, tout aussi ultime dans sa performance, est composé d’un seul mouvement divisé en 6 parties. À la fois virtuose, empreint d’un grand lyrisme et caractérisé (par moments) par une virulence qui prend la forme d’un dialogue envenimé entre le piano et l’orchestre (sur l’Allegro deciso), c’est une oeuvre absolument fantastique et qui mérite autant de reconnaissance que son grand frère (si ce n’est plus). À noter le super passage du Allegro moderato où le violoncelle solo accompagne le piano, jouant une métamorphose splendide du thème d’ouverture.
Nos oreilles ayant déjà pu apprécier d’intenses moments de splendeur racée et voilà qu’arrive « Totentanz » pour conclure le disque de la plus frénétique façon !!! Bordel : si ce n’est pas LA meilleure version de cette oeuvre incomparable, je suis prêt à donner mon âme à n’importe quelle entité méphistophélique ! On apprécie ici Zimerman à son plus TÉNÉBREUX et EMPORTÉ alors que le bon Ozawa, en plein dans son élément, mène son orchestre comme un capitaine de navire fou pendant une tempête acharnée.
Conçue dans l’esprit d’une marche funèbre, cette danse macabre s’appuie sur le thème récurrent tirée de la séquence médiévale Dies iræ (« Prose des Morts ») qui, dès le départ, vient nous plonger dans la noirceur la plus opaque. C’est lourd, inquiétant… Et Zimerman le féroce nous sidère avec son agilité renversante. Les montées et les descentes urgemment démoniaques du piano vous feront à la fois vivre un profond orgasme sonore et vont vous renverser tous les sens… L’orchestre y est passionnant, aussi tendu que souple. Vraiment l’interprétation la plus essentielle de l’oeuvre, avec un final époustouflant !
Ce disque, c’est une rencontre au sommet entre deux maîtres qui rendent justice à un de mes compositeurs préférés de tous les temps. Un must dans la discothèque de tout fan de musique classique !
Dans un même état d’esprit, Salade vous recommande :